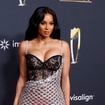En France, seulement 10 % des victimes de viol portent plainte et 1 % de ces plaintes aboutissent à une condamnation. Par-delà ces chiffres terribles, il y a celles et ceux qui grandissent avec des psychotraumatismes liés aux crimes subis. Des femmes, en grande partie, qui bien trop souvent ne trouveront ni l'écoute, ni l'accompagnement nécessaires pour soigner leurs blessures au sein des institutions censées les protéger.
Pour lutter contre ce fléau, et parce que s'y attaquer contribue à attaquer les violences en elles-mêmes, Asiya Bathily, militante féministe, autrice et infirmière de formation, sensibilise le public par le biais de conférences et d'ateliers, notamment à La Maison des femmes de Saint-Denis. Des interventions qu'elle mène également auprès de la communauté musulmane, dont elle est issue, où les mêmes mécanismes de silence et de tabou observés dans la société en général sont opérés, nous précise-t-elle lors d'un long échange par téléphone.
Ce 27 mars, justement, se tient la Journée internationale des femmes musulmanes. 24 heures pour reprendre une parole qui leur est trop fréquemment refusée, niée, et attirer une attention globale sur des sujets et des récits essentiels, appartenant à celles qui se trouvent "à l'intersection de plusieurs oppressions", nous explique Asiya Bathily.
A cette occasion, l'inspirante jeune femme prendra le micro lors d'un talk organisé sur Facebook par l'association féministe et antiraciste Lallab, qui décortique cette année le thème "Femmes musulmanes : de la puissance au pouvoir collectif". Un rendez-vous au cours duquel la militante reviendra sur la lutte qu'elle mène depuis l'écriture et l'auto-publication de son premier livre, Réapprendre à vivre, et la façon dont elle a elle-même fait de son vécu personnel un combat collectif.
Quelques jours avant l'événement, au bout du fil, elle revient sur l'importance de cette journée et de ce qu'elle permet. Elle insiste sur la nécessité d'une meilleure connaissance des psychotraumatismes qui font suite aux violences sexuelles afin de lutter efficacement contre la culture du viol, sur l'urgence qu'il y a à normaliser ce sujet tu, et à apporter un soutien sans faille à celles et ceux qui se confient. Enfin, elle décrypte aussi comment l'islamophobie au sein des institutions policières et de soin peut constituer un frein à la libération de la parole des victimes concernées. Entretien.

Asiya Bathily : En tant que femmes musulmanes, nous nous retrouvons à l'intersection de plusieurs oppressions : sexistes, racistes, islamophobes. Et ces oppressions ont un impact réel sur nos quotidiens. De plus, en France, on parle énormément des femmes musulmanes sans leur donner la parole. Et même quand c'est le cas, il ne s'agit pas forcément d'un dialogue ni de comprendre le point de vue de l'autre, mais d'imposer le sien, bien souvent avec agressivité.
Face à tout cela, le fait d'organiser une journée qui nous soit dédiée nous permet de reprendre la parole d'une part, mais aussi le pouvoir, puisqu'on raconte nos vécus de la manière dont on a envie de les raconter. On redevient sujets et actrices de nos récits. Cela ne peut être que positif, et incarner un moyen de contrebalancer tous les discours sexistes, racistes, islamophobes que l'on peut entendre. Des discours qui, par ailleurs, tournent fréquemment autour du voile, ce qui est aussi réducteur qu'objectivant : on ne parle plus des femmes qui le portent, mais du voile en lui-même.
A. B. : J'utilise plusieurs canaux pour mener mon combat. Je le fais d'ailleurs à grande échelle et pas spécialement au sein de la communauté musulmane, car en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, il n'y a pas de spécialité "musulmane". Avant d'y être sensibilisée, c'est un a priori que j'ai pu avoir, mais en rencontrant d'autres victimes et en ayant une vue plus globale de ce fléau, j'ai réalisé que la manière dont elles sont traitées au sein de la communauté musulmane est la même que dans la société plus largement : par le silence et le tabou.
Concrètement, mon action consiste à sensibiliser les personnes. J'ai réalisé qu'il y avait une grande méconnaissance du sujet des violences sexistes et sexuelles et de leurs répercussions. Ce qui m'importe est que les psychotraumatismes qui surgissent après un viol ou une agression sexuelle ne soient plus méconnus. La société française est imprégnée par la culture du viol et la méconnaissance de ces psychotraumatismes participe à l'alimenter.
Par exemple, certain·e·s vont reprocher aux victimes de ne pas avoir réagi lors d'une agression car s'il n'y a pas eu de lutte, beaucoup ont tendance à remettre en doute leur non-consentement. Sauf que ce qu'on sait peu, c'est que le cerveau humain se met en état de sidération, un mécanisme de protection de la victime. Ou encore le concept d'amnésie traumatique, qui fait oublier une agression, un viol à une personne qui l'a subi, là aussi par protection. C'est ce que j'essaie de vulgariser lors de mes différentes interventions, en me basant principalement sur les travaux de la psychiatre Muriel Salmona.
Le canal de diffusion principal a été mon livre, intitulé Réapprendre à vivre, qui contient mon propre témoignage. Dedans, j'ai voulu mettre l'accent sur la façon dont je me suis reconstruite après le viol que j'ai subi (à 7 ans, ndlr). Le parcours de reconstruction, c'est quelque chose de long, de pas du tout linéaire. En racontant mon histoire, j'ai souhaité d'une part montrer que les répercussions d'un viol durent pendant des dizaines d'années et que ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler, mais aussi dénoncer l'omerta et le fait que les soignant·e·s ne sont pas formé·e·s aux psychotraumatismes.
Je suis moi-même infirmière de profession et je n'ai jamais été formée là-dessus. Pareil pour les psychiatres (ce que déplore d'ailleurs Muriel Salmona, la présidente de l'association Mémoire traumatique), et les policier·e·s. Le fait que tou·te·s ces acteur·rice·s, qui interviennent à un moment ou à un autre du parcours de reconstruction des victimes, ne soient pas formé·e·s, ajoute indéniablement au traumatisme. Lors de mes interventions, j'insiste vraiment sur tous ces psychotraumatismes, et je me suis rendu compte à travers les retours des victimes que je peux avoir, que pour beaucoup de personnes, le fait de poser des mots sur ce qu'elles vivent permet de réaliser qu'il s'agit d'une conséquence normale à un événement anormal.
A. B. : Si dans notre société, il y a des violeurs, c'est que la société leur permet d'exister. En France, seulement 1 % des plaintes pour viols aboutissent à une condamnation. C'est le crime parfait, pourrait-on dire : une personne qui viole a très peu de chance d'être condamnée. La culture du viol où la charge de culpabilité se retrouve inversée, et les victimes silenciées, profite aux violeurs qui peuvent multiplier leurs actes sans crainte. Pour moi, il y a vraiment une complicité sociétale engendrée par l'omerta qui contribue à "fabriquer" des violeurs.
Cependant, montrer que c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements dans notre société qu'il y a des violeurs, c'est aussi ne pas être fataliste. C'est dire que l'on peut mettre des mesures en place pour que les choses changent. La psychiatre et victimologue Muriel Salmona dit souvent que plus tôt on prend en charge une victime de viol, plus tôt on va éviter que les psychotraumatismes s'installent, ce qui va améliorer la qualité de vie des victimes, et par la même occasion, éviter davantage de ces crimes. Il faut savoir qu'une fille qui est violée a plus de risques de l'être à nouveau au cours de sa vie, et un garçon qui est violé, sans prise en charge et sans traitement de sa mémoire traumatique, a plus de risques de devenir agresseur à son tour.
En proposant un accompagnement adapté le plus tôt possible, on peut empêcher tout ça. Encore faut-il s'en donner les moyens.
 © Adobe Stock
© Adobe Stock
A. B. : Ça a mis énormément de temps, ça ne s'est pas fait tout de suite. Après le viol, j'ai subi une amnésie traumatique pendant près de 12 ans. Quand cela m'est revenu, j'avais presque 19 ans. Ça m'a fait l'effet d'une effraction. A ce moment-là, c'est très compliqué de le dire. Quand je me suis rappelée avoir été violée, j'avais cette urgence d'en parler, mais je ne savais pas comment procéder. J'avais peur de comment cela allait être reçu par l'autre, j'avais peur d'être jugée, de changer dans le regard des autres.
Pendant 5 ans à la suite de cela, j'étais dans une forme de déni, où je me disais que le viol ne m'avait pas impactée tant que ça, parce que j'arrivais à avoir une vie semblable à celle des personnes de mon âge. Seulement, au moment où j'ai pris conscience que si, ça m'avait impactée et que je voulais travailler dessus, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec un centre dédié et le délai était de plus de 3 mois. C'était compliqué de gérer cette attente et après coup, j'ai mis très vite fin à ce suivi car la psychologue qui me recevait n'était pas du tout formée aux psychotraumatismes.
J'ai rencontré beaucoup de thérapeutes, j'ai commencé en 2013 et trouvé celle qui m'a aidée en 2016. Il m'a fallu trois ans et six personnes avant de tomber sur quelqu'un de réellement formé. Ça m'a paru interminable, mais toujours selon Muriel Salmona, une victime met en moyenne 13 ans pour trouver un accompagnement. Donc mon parcours était beaucoup plus court en comparaison, et c'est effrayant.
Et puis, il y a les questions qu'on nous pose. "Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ?", "Comment t'étais habillée ?". On a l'impression qu'on doit se justifier d'être une victime et qu'il y a des bonnes réponses à dire. Comme s'il fallait qu'on rentre dans le moule de la "bonne victime". Tout ça est très violent et participe à l'inversion de la responsabilité.
A. B. : Quand j'ai été violée, j'avais 7 ans et j'ai guéri à 27 ans. Par "guérir", j'entends que les psychotraumatismes avaient été traités. La dissociation (une sensation de vivre la situation de l'extérieur, en spectatrice, ndlr) avait disparu, l'anesthésie émotionnelle (un état provoqué par la dissociation qui empêche la victime de prendre mesure de ce qu'elle vécu, ndlr) était levée, et du coup, j'ai pu de nouveau connecter mon corps avec mon esprit. Ça m'a pris 20 ans, ce qui est long, et à côté de ça - et c'est terrible de le formuler, c'est extrêmement court quand on regarde le parcours d'autres personnes aux récits similaires.
Ma grosse prise de conscience est venue en assistant un groupe de parole à la Maison des Femmes de Saint-Denis, le 23 mars 2018, il y a 3 ans. Je me rappelle d'une femme qui avait été violée en 1982 et quand elle en parlait, elle était encore "dissociée". Le traumatisme datait et elle n'en était pas encore guérie. Là, je me suis rendu compte que, bien qu'on soit physiquement entourées, nous victimes, le sentiment d'abandon était commun à tous les récits. Ça m'a énormément questionnée. J'ai ressenti comme une urgence à parler, à raconter, à dénoncer.
Je suis aujourd'hui encore toujours estomaquée par le nombre de femmes qui m'écrivent après mes interventions, de voir qu'on est aussi nombreuses, qu'on essaie de survivre, de vivre comme on peut et qu'on est toutes passées par ces moments d'abandon. Je pense que les personnes qui nous entourent ne sont pas insensibles à ce qui se passe, mais n'ont peut être pas les outils pour voir ni comprendre. C'est pourquoi j'ai voulu faire des actions de sensibilisation en général, sur la population en général, pour leur expliquer, entre autres, que les violences sexistes et sexuelles sont une réalité très présente.
On a un peu l'impression qu'il y a eu une sorte d'avant-après #MeToo, comme s'il n'y avait pas de violences sexistes et sexuelles avant que l'on en parle massivement. Sauf que c'est un fléau très commun qui existe depuis des millénaires, et qui a toujours été silencié. J'ai envie de me dire que là, à notre génération, il faut que ça s'arrête. Je ne veux pas que les générations futures en héritent. Il faut agir maintenant, et agir ça veut dire en parler. Malgré la gêne, pour que cela devienne une conversation "normale", qu'on dépasse ce tabou destructeur.
 © Adobe Stock
© Adobe Stock
A. B. : Je n'ai pas connaissance de chiffres officiels. Mais je suis étudiante dans un centre où je prends des cours de science islamique et avec qui je mène depuis 4 ans des actions de sensibilisation à ces violences. Le corps enseignant et administratif s'est engagé à ce que tous les ans, nous abordions un angle précis autour de ce sujet.
L'année dernière, nous avons voulu faire un sondage à l'intérieur du centre pour interroger les étudiant·e·s. Dans la communauté musulmane, on est dans une forme d'idéalisation où l'on parle très peu de sexualité et on ne pense pas qu'on est touché·e·s par les violences sexistes et sexuelles. Sauf que lors de ma première intervention, sept personnes m'ont contactée pour me raconter ce qu'elles avaient vécu, donc j'ai voulu enquêter davantage.
On est environ 700 étudiants, on a reçu 110 réponses au sondage et parmi celles-ci, 50 personnes confiaient avoir été violées. Pas loin d'une personne sur deux. Ces résultats reflétaient également des points qui existent à plus grande échelle : la majorité des répondant·e·s racontaient avoir été violé·e·s avant 18 ans, par une personne proche, et n'avaient pas mis en place d'action particulière pour guérir.
A. B. : Je pense, oui. Le fait de savoir qu'il y a de l'islamophobie au sein des institutions qui sont censées nous protéger va engendrer de la méfiance. Et donc, une crainte de s'y rendre. Par rapport au viol, des freins entrent déjà en jeu lorsqu'on se retrouve en face de policier·e·s ou de soignant·e·s lorsqu'on est une femme, alors en tant que femme musulmane racisée, on se dit que ça peut être des freins supplémentaires.
De plus, dans les témoignages que je reçois, certaines me disent que lorsqu'elles vont voire un·e psychologue pour raconter leur histoire, on va souvent renvoyer leur agression à leur origine ethnique, à leur culture, à leur religion, comme pour montrer l'altérité de ces personnes, et qu'une agression dans leur contexte culturel, religieux est quelque chose de légitime. Alors que pas du tout.
Le fait d'entendre ce genre de discours prive la personne de son histoire, de son récit. Et même si toutes les cultures ont leurs points positifs et négatifs, nous n'avons pas envie que notre culture ou notre religion, qui fait partie de nous, soit remise en question. Et nous ne sommes pas là pour parler de ça. Ces violences sexistes et sexuelles ne sont pas propres à une culture ou à une religion, mais bien au patriarcat qui gangrène le monde depuis trop longtemps !
A. B. : Pour commencer, comme pour toutes les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, je leur dirais que je les crois. Je dirais aussi à ces personnes qu'elles ne sont pas responsables. C'est important de l'entendre. Avec l'inversion de la charge de responsabilité et le patriarcat, on est dans un schéma où la femme est la tentatrice, à l'origine de tous les maux. Aucune victime n'est responsable, seul l'agresseur l'est : je le répéterai tout le temps car il faut que ça devienne un automatisme.
Elles ne sont jamais fautives. Même si le cheminement pour arriver à la guérison est long et difficile, il est nécessaire. Et quand on l'emprunte, c'est un cadeau qu'on se fait. On va évidemment passer par des moments très durs, mais elles ne sont pas seules à les traverser. Je les soutiens même si je ne les connais pas toutes, et je suis sûre que dieu aussi.
A. B. : Déjà, je dirais que l'on est tou·te·s concerné·e·s mais qu'on ne le sait pas forcément. Je pense que si l'on pose la question lors d'un repas entre ami·e·s, d'une réunion familiale, au bureau, on serait surpris·e·s de voir le nombre de personnes concernées. C'est partout autour de nous.
Pour aider, lorsqu'une victime vient nous voir et nous raconte son histoire, c'est essentiel d'être dans une écoute active et surtout bienveillante. A savoir, on ne remet pas en question le vécu, ni les sentiments de la personne, et on l'écoute simplement. Ensuite, c'est très important de dire aux victimes qu'on les croit.
On est tou·te·s plus ou moins imprégné·e·s par la culture du viol. Elle est elle aussi partout. Il faut conscientiser les biais que l'on a par rapport à ça, et les déconstruire petit à petit. En France, en 2021, on a énormément d'outils, de sources fiables, qui nous permettent de travailler là-dessus. Déconstruire la culture du viol c'est pour moi ce qu'il y a de plus compliqué et pourtant, c'est à mon avis l'action majeure à entreprendre.
Il faut sensibiliser les parents à éduquer les enfants, car ce sont principalement eux et elles qui sont victimes. C'est très important de leur apprendre le respect de leur corps, de ne pas avoir peur des mots, et de leur dire que si quelqu'un les touche au niveau de leurs parties intimes, ou leur montre les leurs, qu'ils sachent qu'il faut aller voir un adulte de confiance pour leur en parler. Et en tout dernier recours, faire des dons aux structures qui accompagnent les victimes car une prise en charge coûte cher, c'est long. Tout le monde ne peut pas le faire et la santé mentale ne devrait pas être un luxe. Lorsqu'on est victime, on ne devrait pas être, en plus, victime d'un manque d'accès aux soins.
Mais surtout, il est indispensable d'en parler, de faire de ces violences un sujet de discussion accessible, pour que le tabou diminue. L'évoquer librement pour encourager les autres à dire. Je le vois bien, quand je raconte mon histoire lors de mes interventions, il n'y a pas un endroit où personne n'est venu·e me voir en me disant "moi aussi j'ai vécu quelque chose de similaire".
Je le répète : plus on va en parler, en faire un sujet de conversation de tout le temps, partout, de tous les espaces, de tous les endroits, plus les concerné·e·s vont se sentir à l'aise et se confier. Et enfin, plus le silence disparaîtra.
Rendez-vous samedi 27 mars de 10h30 à 17h30 pour un évènement en ligne organisé par Lallab, où seront tenus talks et table ronde dans le cadre de la Journée internationale des femmes musulmanes.